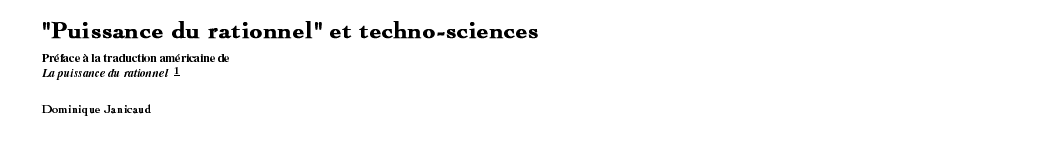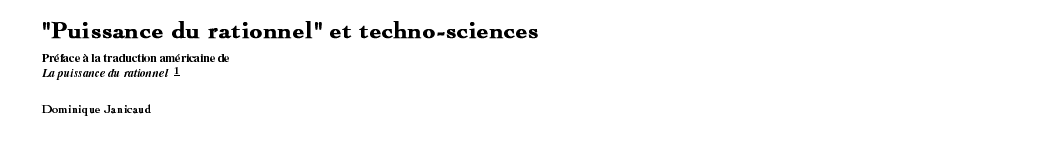
Nul ne peut contester qu'en un laps de temps relativement court
(en comparaison de l'histoire et surtout de la préhistoire de l'humanité)
les sciences et les techniques ont transformé notre planète
au point d'ébranler des équilibres écologiques et
ethnologiques immémoriaux, au point surtout de faire douter l'homme
du sens de son existence et de ses travaux, jusqu'à faire vaciller
sa propre identité. Deux guerres mondiales et l'accélération
de la compétition technologique à l'échelle planétaire
ont imposé une remise en question de l'idéal éclairé
du Progrès, sans qu'un nouveau modèle aitpu donner un contenu
satisfaisant à la notion de "développement". La puissance,
devenue réalité sous des formes qui n'avaient pas été
prévues, a pris l'humanité de vitesse. Aucune réflexion
éthique n'a pu précéder, prévenir, ni encadrer
la mise au point d'armes de destruction massive, l'émergence d'une
ingèniérie génétique, l'informatisation universelle
d'une multitude d'opérations discursives et pratiques. Exposée
aux tentations extrêmes du cynisme et du nihilisme, l'humanité
voit-elle son destin lui échapper ?
Ecrasant noeud de difficultés qui semblent excéder
le champ et les moyens de la rationalité classique! Aucune vision
jusqu'ici proposée de l'histoire n'est à la mesure de cet
éclatement des possibles, que Nietzsche fut sans doute le seul à
prédire. En écrivant La puissance du rationnel, j'ai
voulu affronter cette situation, sans disjoindre -sous la pression de l'actuel
ou de l'inédit- les questions les plus fondamentales posées
depuis Kant sur le sens de la rationalité.
A la première lecture du titre, on peut croire que ce
livre a pour but l'apologie de la rationalité.
En fait, il faut donner à "la puissance du rationnel"
un sens phénoménologique (et non métaphysique ou même
simplement laudatif). Le point de vue adopté n'est ni rationaliste
ni antirationaliste. Il est celui d'un observateur qui constate qu'une
certaine rationalité (celle qui fait s'allier de plus en plus étroitement
les sciences et les techniques) produit des effets de puissance sans précédent.
Les lignes de rupture les plus décisives ne sont pas forcément
aussi spectaculaires que la menace de destruction thermo-nucléaire
; le génie génétique est gros de mutations du type
humain lui-même ; l'informatisation de l'archivage et de la communication,
le développement systématique de ce que l'on appelle "l'intelligence
artificielle", l'ultra-rapidité des transmissions mondialisées
précipitent l'instrumentalisation du langage. Devant de tels phénomènes,
il devient impossible de s'abriter derrière l'ancienne distinction
entre science (désintéressée) et technique (appliquée)
: on assiste à une redistribution complète des relations
entre science et puissance, entre rationalité et domination. I1
faut procéder à de nouvelles distinctions, aussi bien du
côté de la puissance que du côté du rationnel.
En aval (quand on observe les effets de puissance), on doit
reconnaître des écarts massifs, incalculables et irréversibles,
qui ne s'expliquent par aucun des ressorts traditionnels de la puissance
(goût de l'or, volonté individuelle de puissance, ou même
lutte entre classes sociales). En amont (à partir du rationnel comme
tel), la production de puissance (ou potentialisation) n'a rien à
voir avec une "tyrannie" directe du logique : il faut distinguer plusieurs
phases dans la potentialisation rationnelle (lesquelles ne sont nullement
assimilables à des époques) : ces quatre régimes d'accroissement
de puissance sont en principe compossibles, quoiqu'un déséquilibre
de plus en plus marqué s'opère de nos jours au profit quasi
exclusif de la phase d'autonomisation du Complexe techno-scientifique (que
je nomme phase IV).
Le recours à l'épithète "phénoménologique"
pour caractériser la première étape de cette recherche
a pu surprendre, dans la mesure où ni le noyau de la thèse
(la potentialisation rationnelle, ni son développement (le déploiement
des effets de puissance de la raison) ne semblent pouvoir faire stricto
sensu l'objet d'une phénoménologie critique de type husserlien
; la puissance n'est pas une essence qu'une visée pourrait stabiliser
comme un corrélat, mais un rapport différentiel, sans cesse
mouvant -et dont l'extériorité vient durement rappeler le
caractère finalement impensable de l'autoprésupposition de
la rationalité. Tout en concédant que la présente
étude ne pouvait pas revendiquer le sens majeur, ou totalisant,
de la phénoménologie, j'y présume une neutralisation
du regard accueillant les effets de puissance rationnels tels qu'ils adviennent,
sans jugement de valeur ; une phénoménologie minimale permet
de constater et de décrire l'effectuation la plus massive, celle
de la Puissance contemporaine, puis d'en préparer un décryptement
plus différencié (c'est alors que la phénoménologie
est relayée par une généalogie diacritique des phases
de la potentialisation). Nietzsche a parlé de la "terreur de
l'incalculable comme arrière instinct de la science" (2)
: c'était déjà faire signe vers la limite de toute
phénoménologie lorsqu'on a à faire à un gigantesque
mouvement historique, s'imposant comme un destin et dont les "résultats"
semblent excéder toute "intention". Il n'empêche que diagnostic
et méditation doivent d'abord s'appuyer sur une observation (aussi
"neutre" que possible) des phénomènes : attention phénoménologique
plus que jamais nécessaire en ce temps d'innovations technologiques
accélérées. Les idéologies interdisent cette
ouverture d'esprit (le marxisme-léninisme en a été
un exemple accablant) ; plus subtilement, la philosophie peut faire prendre
parti trop tôt ; c'est le cas avec l'apologie nietzschéenne
de la volonté de puissance.
Avons-nous pratiqué une épokhè assez radicale
de toute lecture réactive ou métaphysique des potentialisations
rationnelles ? Et, d'autre part, le recul a-t-il été assez
grand par rapport à l'interprétation heideggérienne
elle-même ? Certains ont suspecté La puissance du rationnel
d'être une version soft de la thèse destinale heideggérienne
sur l'essence de la technique moderne. C'est méconnaître les
nombreux passages où distance est prise à l'égard
de la réduction au Gestell de la complexité des phases de
la potentialisation rationnelle, où l'on avertit également
le lecteur du danger d'un manichéisme séparant le monde technique
de sa vérité profonde et réservée. Il y a donc,
dans ce livre, un dialogue tendu avec la pensée heideggérienne
; le titre même en témoigne : repartir de la "puissance
du rationnel", en un sens toujours ambigu, c'est prendre le contre-pied
d'un pur et simple repli sur la pensée méditante ; ce dialogue
s'élargit dans "La rationalité comme partage" (II,
4) à l'héritage hégelien et à la lucidité
hypercritique. Les divergences principales vis-à-vis de la pensée
heideggérienne peuvent être ainsi résumées :
on ne présuppose plus d'envoi de l'être (comme unité
appropriante), ni un Evénement historial en attente (recours "eschatologique")
; la maîtrise de l'étant n'est plus comprise à partir
de la seule métaphysique -mais différenciée en phases
; il en résulte que le monde grec ne doit plus être interprété
uniquement en fonction du retrait de l'A-letheîa authentique,
et que le monde contemporain n'est plus strictement unifiable autour d'une
"essence" comme le Gestell ; le "recours", s'il est pensable, n'est
pas une pure attente (même si celle-ci est respectable) : il implique
également tout un travail d'intelligence de notre partage.
Une autre grande référence dont l'ombre s'étend
sur le livre est Nietzsche. On m'a fait remarquer l'absence d'une explication
thématique et poussée avec cette grande pensée. Cette
observation, justifiée en principe, appelle une double réponse
: la première et la plus évidente est que cette explicitation
aurait exigé des développements très importants, en
particulier sur le Nietzsche de Heidegger, qui auraient déporté
le propos du livre vers l'herméneutique de la métaphysique
moderne ; la seconde est en droit d'attirer l'attention sur le fait que
Nietzsche n'est pas vraiment absent de ce livre, mais qu'il est intentionnellement
tenu à distance. Les raisons profondes devront un jour en être
totalement explicitées. Ce qui apparaît, dès à
présent, c'est que La puissance du rationnel engage un mouvement
de pensée libéré de tout prophétisme et un
processus de catharsis envers la volonté de puissance.
En revanche, il est un point où la présente recherche
vient converger avec une orientation de pensée qui se retrouve à
la fois chez Hegel, Nietzsche et Heidegger : la prise en compte du mouvement
historial dominant de l'Occident oblige à minorer le rôle
des individus. La dynamique actuelle de la potentialisation échappe-t-elle
totalement au contrôle humain ? I1 faut ici distinguer entre l'irréversibilité
du processus (il y a consensus sur le fait qu'on ne peut pas revenir purement
et simplement en arrière, comme si les progrès techniques
étaient annulables) et, d'autre part, l'autonomisation de la sphère
techno-scientifique (j'ai constaté une tendance ; je n'ai pas prétendu
que le système global, refermé sur lui-même, échapperait
à toute forme de contrôle humain). Quoique irréversible,
le processus reste ouvert.
Ce qui est certain, c'est qu'un rejet schématique et
trop rapidement unificateur de la Technique risque de conduire à
l'effet inverse de ce que la meilleure intention recherchait : au lieu
de préparer un "salut", on risque d'accentuer encore la séparation
entre les intellectuels et le cours effectif du monde ; on éloignera
alors la possibilité d'articuler le possible sur le réel
(surtout du point de vue politique). On a donc fait le pari d'échapper
à la fois à la vision sotériologique du dernier Heidegger
("seul un dieu peut nous sauver") et à la réduction
purement et simplement techniciste.
Il ne s'agit pas d'un choix uniquement subjectif ; il faut
y voir surtout la conséquence logique de la théorie des phases
de la potentialisation, laquelle remplace une philosophie unifiée
de l'histoire. La phase IV est ultime en ce sens qu'elle est la dernière
apparue et qu'elle est celle qui dégage le plus de puissance, mais
elle ne tarit pas complètement (pour l'instant du moins) les autres
phases, ni le possible qui reste ouvert sur l'imprévisible. Le possible
historique excède le possible logique, lequel ne reste pas lui-même
aussi sagement enclos dans la non-contradiction que l'avait cru Kant. Il
n'y a donc de "fin de l'histoire" en aucun sens : les philosophies englobantes
qui diffusaient ce mythe ont perdu leur validité et même leur
vraisemblance, malgré tous les essais de réanimation artificielle.
En fonction de la même logique interne, il ne faut pas
entendre le terme "techno-science" en un sens substantialiste, ni excessivement
unificateur. La coexistence de plusieurs phases implique que le projet
scientifique puisse préserver une relative autonomie par rapport
aux problèmes purement techniques. Comme l'a noté Jean Ladrière
(3), la science va à l'inverse de la technique
en tant qu'elle "informe les organisations", alors que la technique
organise des informations ; mais cette tension et cette différence
maintenues entre science et technique s'inscrivent à l'intérieur
d'une convergence globale et effective entre sciences et techniques. A
cet égard, il eût été plus juste de parler de
technosciences (au pluriel), plutôt que de la Technoscience en un
sens absolument unifié.
L'occasion se présente ainsi d'ouvrir le discours philosophique
vers les réalités scientifiques qui se font : je souhaiterais
vivement être lu (et critiqué) par des scientifiques, encore
plus que je ne l'ai été en France. L'obstacle au dialogue
réside, en grande partie, dans un malentendu qui persiste sur le
sens du "pouvoir". Quand le physicien Georges Waysand remarquait récemment
que "le pouvoir de la science se construit en éliminant le pouvoir
du scientifique" (4), il mettait le doigt sur une
réalité tout autre et bien plus décisive que le pouvoir
direct d'un homme.
Tout progrès scientifique résulte d'un processus
cumulatif qui rend possible à son tour d'autres découvertes
scientifiques, de nouvelles applications techniques.
Le vecteur de ce gonflement global de puissance n'est plus
un individu, fût-il génial, ni même un groupe : c'est
en principe la communauté scientifique ; c'est, au niveau de la
mise en oeuvre effective et des bénéfices directs, un Etat,
une société multinationale, une institution ad hoc du genre
NASA ou CERN, etc.
La subordination de l'individu intervient alors selon deux
facteurs : l'objectivation et le gigantisme. La première a gouverné
depuis les mathématiques grecques la démarche proprement
épistémique : dès qu'un théorème, une
suite de démonstrations sont compris et formulés, ils n'appartiennent
plus à leur auteur, ils valent par la cohérence interne qu'un
homme s'est borné à faire apparaître ; Euclide, à
cet égard, n'est pas plus "personnalisable" que Bourbaki. En gagnant,
à partir du XVIIe siècle, la connaissance du monde physique,
puis progressivement de nouveaux secteurs de la réalité (y
compris "humaine"), l'exigence d'objectivité a renforcé les
contraintes qui constituent ce que Popper appelle la "tradition scientifique"
(5), et qui sont autant de garanties contre une régression
à la subjectivité ou à l'arbitraire.
Le gigantisme n'est pas en soi une invention du XXe siècle,
mais ce dernier lui a fait franchir des seuils nouveaux et spécifiques,
au moins selon deux points de vue : l'accroissement considérable,
surtout depuis un demi siècle, des dimensions de la communauté
scientifique et, en particulier, du nombre des publications ; le lancement,
depuis le Manhattan Project (le plan secret de la première
bombe atomique américaine), d'énormes programmes technico-industriels
(militaires, spatiaux, informatiques, médicaux) où les acquis
scientifiques ne sont pas simplement utilisés "entre autres", mais
où les scientifiques sont mis au travail en fonction de commandes
très intéressées.
Il faut tirer les conséquences de ces faits connus,
pour accroître notre intelligence du problème des potentialisations
rationnelles ; la question du (petit) pouvoir du savant comme individu
n'est plus du tout à la hauteur de ce qui advient véritablement.
A la première subordination (noble et consciemment assumée)
issue de l'objectivité, se sont surajoutées les contraintes
spécifiques de la Big Science. I1 en résulte cette
situation paradoxale et frustrante pour le chercheur : il paraît
avoir, en tant qu'individu, d'autant moins d'importance (du moins en règle
générale) que la science gagne en possibilités et
en puissance, en tant que processus global !
La tentation est alors grande pour le scientifique de se désintéresser
des problèmes de l'insertion de la science dans la société
et des questions d'avenir (morales, culturelles, etc.) qui en dépendent.
Tentation d'avoir une conception purement fonctionnelle du travail scientifique.
Cette tentation est une variante du technicisme. Elle doit être critiquée
au même titre que ce dernier.
Puisqu'il est question de critiques, faut-il préciser
que l'auteur du présent livre ne s'exclut pas du jeu sévère
et nécessaire d'une incessante révision des formulations
et des résultats d'une recherche qui doit être poursuivie
? Tout en maintenant l'orientation générale et les thèses
fondamentales de ce livre, il faut concéder que je ne l'écrirais
pas aujourd'hui tout à fait de la même façon. Les corrections
les plus importantes concerneraient les points suivants : la séquence
sur "La technique dans le langage" (I, 4) manifeste un pessimisme
excessif quant à la technicisation des langues naturelles : il est
sans doute possible de trouver un équilibre entre ce pessimisme
et l'optimisme extrême d'un Umberto Eco (6) ;
la "règle de Gabor" (formulée à la fin de la partie
I) a une valeur heuristique, mais elle ne fonctionne pas mécaniquement
; l'antinomie entre la technicisation et l'éthique n'est pas toujours
directe ; il faut tenir compte, en particulier, de facteurs économiques,
lesquels ne jouent pas automatiquement en faveur de l'innovation technique
la plus poussée (le facteur de rentabilité n'est pas forcément
plus "moral", mais il n'est pas non plus strictement technique) ; en ce
qui concerne la Nouvelle Science (en II, 2), le ton employé a été
certainement trop polémique ; du moins a-t-on pu ainsi signaler
un risque de mythification de la science contemporaine, une nouvelle forme
possible de scientisme (7).
Il est évident, par ailleurs, que des allusions à
l'actualité ont dû être corrigées. En moins de
dix ans, la situation politique mondiale a incroyablement changé.
Les bouleversements intervenus invalident-ils un examen critique des potentialisations
rationnelles ? Nullement. Mais il faut tenir compte d'une modification
importante : les irrationalités résultant de la course mondiale
à la puissance se déplacent de l'axe Est/Ouest vers un axe
Nord/Sud et une balkanisation des conflits.
La fragilité des essais de régulation n'en apparaît
que plus clairement (la conférence de Rio sur l'écologie
en est un exemple) : constat peu réjouissant qui ne doit pas décourager
de nouveaux efforts. Le cas de la situation alarmante de l'ex-URSS et des
anciens satellites en matière de danger nucléaire est également
à retenir : les aberrations proprement politiques d'une forme spécifique
de totalitarisme ont intensifié des dangers techniques qui existent
aussi potentiellement ailleurs. S'il est vrai que le risque technologique
majeur est désormais une réalité planétaire,
le problème de son contrôle ne se pose pas toujours en termes
strictement techniques. L'analyse des pouvoirs du rationnel (et de leurs
renversements irrationnels) doit être constamment réactualisée,
puisque la puissance hypermoderne se repotentialise sans cesse. La grande
erreur des marxistes a été de croire que l'oeuvre de Marx
pouvait se gérer comme un capital !
Ces mises au point incitent certes à redoubler de prudence
dans les analyses concrètes, et surtout dans toute projection anticipant
à l'excès sur l'avenir ; elles montrent aussi que la question
des pouvoirs du rationnel ne doit pas être appréciée
en fonction des dimensions restreintes et des mouvantes inflexions de l'actualité,
mais qu'elle conditionne la conjoncture et oblige à mesurer la profondeur
angoissante de notre destin de puissance.
Le livre, avec ses qualités et ses défauts, n'entend
être rien de plus qu'une contribution à des recherches qui
doivent être prolongées, en particulier sur le lien entre
les potentialisations rationnelles et les formes les plus avancées
du capitalisme : l'effondrement du socialisme d'Etat rend cette réflexion
encore plus urgente. Mon voeu est que le chantier ouvert par La puissance
du rationnel ne soit pas clos de sitôt.
Notes
-
Paris, Gallimard, 1985. Traduction américaine
: Power of the rational, Indiana University Press 1994.
-
Friedrich Nietzsche, Oeuvres philosophiques complètes,
XII, Fragments posthumes, Automne 1835-automne 1887, p. 189.
-
Jean Ladriere, Les enjeux de la rationalité,
Paris, Aubier, 1977, p. 63.
-
Georges Waysand, "Szilard et Majorana", Les pouvoirs
de la science, textes recueillis par D. Janicaud, Paris, Vrin, 1987 p.
220.
-
Voir Karl Popper, "Pour une théorie rationaliste
de la tradition", Conjectures et réfutations, trad. de Launay, Paris,
Payot, 1985, pp. 183-205.
-
Voir son interview récente au journal Le Monde
(29 septembre 1992) où il affirme : "Aucune révolution technologique
ne peut tarir une langue".
-
Nous avons développé et nuancé
le dialogue avec ce courant de pensée dans A nouveau la Philosophie,
Paris, Albin Michel 1991, pp. 141-149.